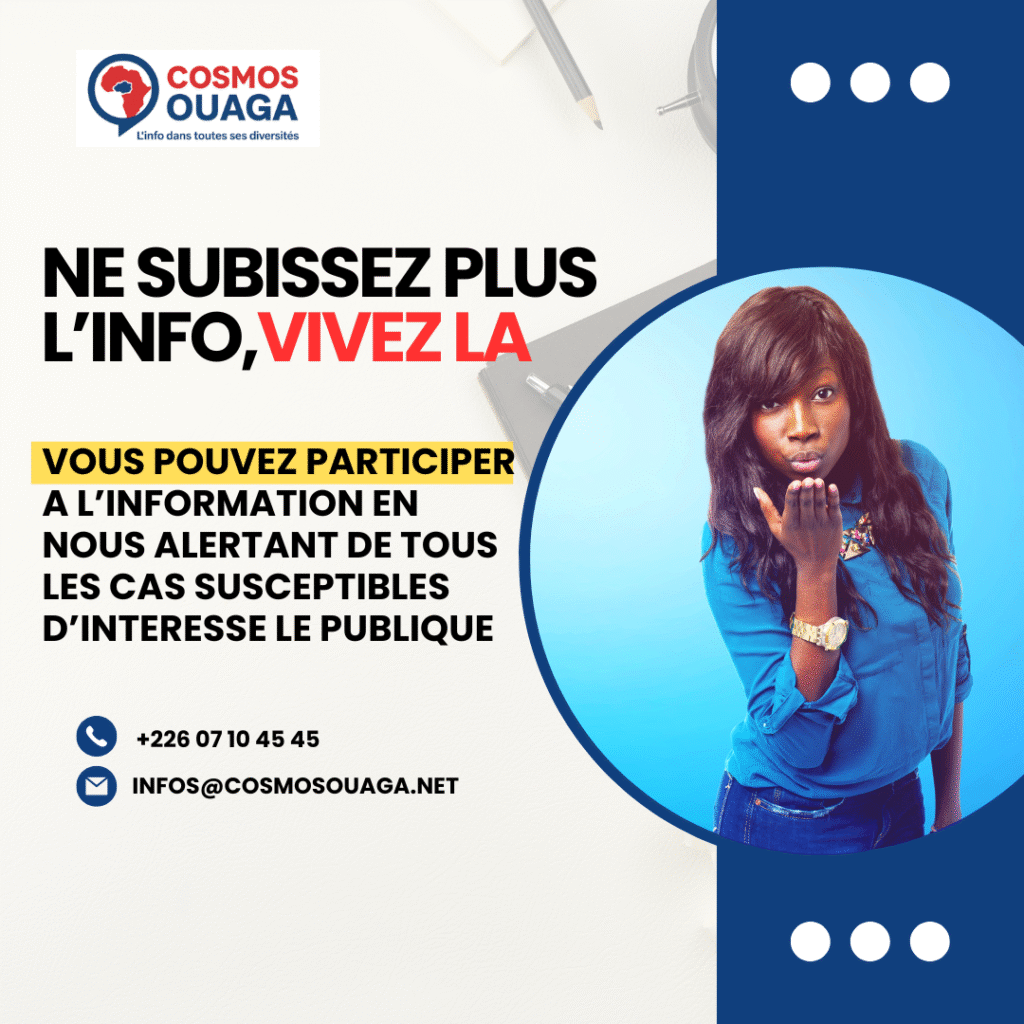La question divise régulièrement les rédactions des médias qui diffusent des informations en langues nationales.
Au Burkina Faso, 98 % des journalistes qui présentent des informations en mooré, dioula, fulfuldé ou autres, traduisent directement à partir d’un texte rédigé en français. Cette méthode présente à la fois des avantages et des inconvénients.
Les avantages
Cette approche est relativement simple et donc accessible à la majorité des journalistes après seulement quelques heures d’exercices et de formation. Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié le mooré, ni même de savoir l’écrire. Toutefois, il reste essentiel de bien comprendre la langue dans laquelle on souhaite véhiculer l’information ou présenter le journal.
Les inconvénients
Cette méthode manque souvent de précision. Les traductions sont parfois approximatives et subjectives, ce qui entraîne des risques de mauvaise compréhension. De plus, la rédaction n’a aucune garantie quant à la manière dont le journaliste effectuera la traduction en direct, une fois à l’antenne.
La revue de presse de la Radio Savane FM a déjà été la cible de critiques pour cette raison.
Au Burkina Faso, il est largement admis qu’on puisse présenter un journal en mooré, dioula ou fulfuldé sans savoir écrire un seul mot de ces langues. En revanche, dans les médias internationaux, cette pratique est quasiment impossible, voire interdite. Dans ces rédactions, tout le texte doit être rédigé de A à Z dans la langue choisie, puis validé par l’équipe éditoriale avant diffusion.
Cette méthode “intégrale” a, elle aussi, ses avantages et ses limites.
L’avantage principal réside dans la maîtrise du contenu et la précision des idées diffusées à l’antenne. Cependant, elle demande une solide formation dans la langue concernée, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Ici, il n’y a pas de place pour l’improvisation.
Parmi les inconvénients, on note souvent la perte de “l’accent” naturel de la langue. En lisant un texte mot pour mot, les journalistes privilégient une diction parfaite au détriment de l’intonation authentique. Conséquence : même les auditeurs visés peuvent avoir du mal à comprendre le message.
C’est le cas, par exemple, des cette jeune dame, journaliste de RFI présentant en bambara (dioula). Certains affirmeront que son niveau est excellent, certes, mais en réalité, il s’agit d’un bambara dépourvu par moment de son accent naturel, ce qui nuit à la compréhension.
Pour répondre à ces défis, la FIMJART (Formation d’Initiation aux Métiers du Journalisme et de l’Animation Radio et Télé) a intégré dans ses programmes la formation mooré, dioula et fulfuldé, afin de valoriser davantage les langues locales dans les médias.
✍️ Assane BAGAYA
Journaliste et Spécialiste Média